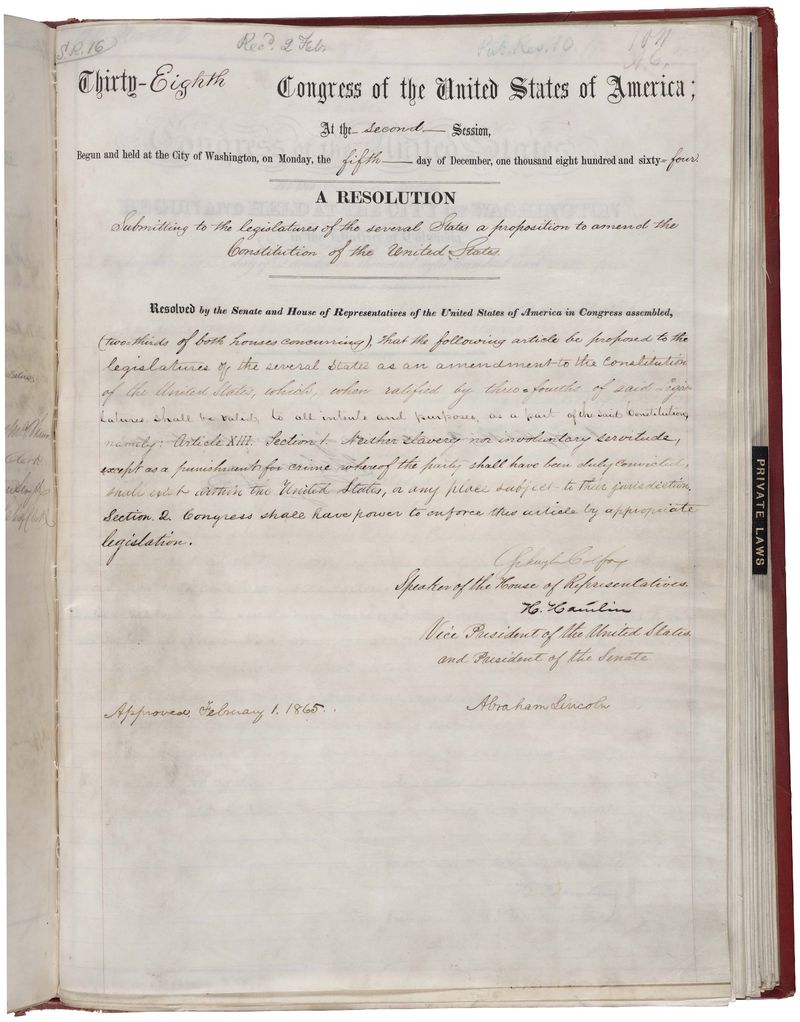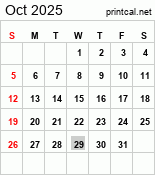Elle est devenue emblématique des mouvements pour la libération des femmes, pour l’
humanisme
en général, et l’importance du rôle qu’elle a joué dans l’histoire des
idées a été considérablement estimé et pris en compte dans les milieux
universitaires.
(...)
La fin
En 1793, elle s’en était vivement prise à ceux qu’elle tenait pour responsables des
atrocités des 2 et 3 septembre 1792:
«le sang, même des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les Révolutions». Elle désignait particulièrement
Marat,
l’un des signataires de la circulaire du 3 septembre 1792, proposant
d’étendre les massacres de prisonniers dans toute la France. Soupçonnant
Robespierre d’aspirer à la
dictature, elle l’interpella dans plusieurs écrits, ce qui lui valut une dénonciation de
Bourdon de l'Oise au
club des Jacobins.
Dans ses écrits du printemps 1793, elle dénonça la montée en puissance de la dictature montagnarde, partageant l’analyse de
Vergniaud sur les dangers de dictature qui se profilait, avec la mise en place d’un
Comité de salut public, le 6 avril 1793, qui s’arrogeait le pouvoir d’envoyer les députés en prison. Après la mise en accusation du parti
girondin tout entier à la
Convention,
le 2 juin 1793, elle adressa au président de la Convention une lettre
où elle s’indignait de cette mesure attentatoire aux principes
démocratiques (9 juin 1793), mais ce courrier fut censuré en cours de
lecture. S’étant mise en contravention avec la loi de mars 1793 sur la
répression des écrits remettant en cause le principe républicain – elle
avait composé une affiche à caractère fédéraliste ou girondin sous le
titre de
Les Trois urnes ou le Salut de la patrie, par un voyageur aérien –, elle fut arrêtée par les Montagnards et déférée le 6 août 1793 devant le
tribunal révolutionnaire qui l’inculpa.
Malade des suites d’une blessure infectée à la prison de l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, réclamant des soins, elle fut envoyée à
l’infirmerie de la Petite-Force, rue Pavée dans le Marais, et partagea
la cellule d’une condamnée à mort en sursis,
Mme
de Kolly, qui se prétendait enceinte. En octobre suivant, elle mit ses
bijoux en gage au Mont-de-Piété et obtint son transfert dans la maison
de santé de
Marie-Catherine Mahay,
sorte de prison pour riches où le régime était plus libéral et où elle
eut, semble-t-il, une liaison avec un des prisonniers. Désirant se
justifier des accusations pesant contre elle, elle réclama sa mise en
jugement dans deux affiches qu’elle avait réussi à faire sortir
clandestinement de prison et à faire imprimer. Ces affiches – «Olympe
de Gouges au Tribunal révolutionnaire» et «Une patriote persécutée»,
son dernier texte – furent largement diffusées et remarquées par les
inspecteurs de police en civil qui les signalent dans leurs rapports.
Traduite au Tribunal au matin du 2 novembre, soit quarante-huit
heures après l’exécution de ses amis Girondins, elle fut interrogée
sommairement. Privée d’avocat elle se défendit avec adresse et
intelligence. Condamnée à la peine de mort pour avoir tenté de rétablir
un gouvernement autre que
« un et indivisible », elle se déclara enceinte. Les médecins consultés se montrèrent dans l’incapacité de se prononcer, mais
Fouquier-Tinville décida qu’il n’y avait pas grossesse.
Le jugement était exécutoire, et la condamnée profita des quelques
instants qui lui restaient pour écrire une ultime lettre à son fils,
laquelle fut interceptée. D’après un inspecteur de police en civil, le citoyen Prévost, présent à l’exécution, et d’après le
Journal de
Perlet ainsi que d’autres témoignages, elle monta sur l’échafaud avec courage et dignité, contrairement à ce qu’en disent au
XIXe siècle l’auteur des mémoires apocryphes de
Sanson et quelques historiens dont
Jules Michelet. Elle s'écriera, avant que la lame ne tombe :
«Enfants de la Patrie vous vengerez ma mort». Elle avait alors 45 ans.
Son fils, l’adjudant général Aubry de Gouges, par crainte d’être
inquiété, la renia publiquement dans une «profession de foi civique». Le procureur de la
Commune de Paris,
Pierre-Gaspard Chaumette, applaudissant à l’exécution de plusieurs femmes et fustigeant leur mémoire, évoque cette
«virago,
la femme-homme, l’impudente Olympe de Gouges qui la première institua
des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut
politiquer et commit des crimes [...] Tous ces êtres immoraux ont été
anéantis sous le fer vengeur des lois. Et vous
voudriez les imiter? Non! Vous sentirez que vous ne serez vraiment
intéressantes et dignes d’estime que lorsque vous serez ce que la nature
a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient
respectées, c’est pourquoi nous les forcerons à se respecter
elles-mêmes».
Olympe de Gouges à l’échafaud